|
La loi instaure un partage des biens plus rapide,
allège la fiscalité pesant sur les prestations compensatoires et clarifie
le régime juridique des donations entre époux.
Le divorce place souvent les époux dans une
situation financière délicate et s'accompagne d'une forte baisse de leur
niveau de vie. Ils doivent se reloger, se remeubler, et payer, le cas
échéant, une prestation compensatoire.
Le partage rapide des biens s'avère indispensable
pour prendre ce nouveau départ. Sans modifier sur le fond les règles du
partage, la loi incite les époux à régler rapidement ce point: pour un
divorce par consentement mutuel, il doit être prévu dans la convention de divorce.
Dans les autres cas, l'assignation en divorce
doit être accompagnée d'un projet de règlement de leurs intérêts
patrimoniaux et pécuniaires.
Le juge peut par ailleurs désigner un notaire dès
l'audience de conciliation pour établir un projet de liquidation.
Si les époux ne procèdent pas au partage d'un
commun accord (ils peuvent à tout moment signer une convention), le juge
ordonnera dans le jugement de divorce le partage de leurs biens.
Une prestation compensatoire pour solde de tout compte
Le juge aura également à fixer la prestation
compensatoire, si les époux ne l'ont pas fait.
La loi les y autorise en effet désormais, même
s'ils sont engagés dans un divorce contentieux.
Cette indemnité forfaitaire, due par un époux à
l'autre, vise à compenser la disparité de leurs conditions de vie après
leur rupture (indépendamment, dorénavant, des torts éventuels d'un époux à
l'égard de l'autre). Le juge tient compte de la durée du mariage, de l'âge
et de l'état de santé des époux, de leur situation et de leur qualification
professionnelle, ainsi que des conséquences éventuelles du mariage sur leur
carrière, en particulier si l'un des époux a cessé son activité pour se
consacrer à l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son
conjoint.
Mais le juge ne doit pas s'arrêter à la situation
présente. Il faut également qu'il tienne compte des héritages que chacun
des époux peut espérer et de la pension de retraite à laquelle ils pourront
prétendre.
La prestation peut prendre la forme d'une somme d'argent
ou d'un bien (logement, valeurs mobilières...).
Si l'époux qui doit la prestation ne peut la
verser en une seule fois, le juge peut prévoir un étalement, sur 8 ans
maximum.
Très exceptionnellement, lorsqu'un époux est
incapable de subvenir seul à ses besoins, la prestation peut prendre la
forme d'une rente à vie, ou d'un capital complété d'une rente (usufruit du
logement familial et rente par exemple).
Autre volet de la réforme, les modalités d'imposition
de la prestation compensatoire ont été aménagées selon la façon dont elle
est versée (voir tableau sur la nouvelle fiscalité des prestations
compensatoires).
Le redevable d'un capital élevé aura intérêt à
étaler son versement sur plus de 12 mois, pour bénéficier, au lieu d'une
unique réduction d'impôt, plafonnée à 7 625 €, de la déductibilité
intégrale de ses versements.
À l'inverse, un versement sur moins de 12 mois
sera plus avantageux pour le bénéficiaire, sauf s'il est peu ou pas imposable.
Enfin, le sort des héritiers du débiteur de la
prestation est également amélioré, même s'ils sont tenus de payer
immédiatement le solde restant dû si le redevable de la prestation
compensatoire décède avant qu'elle n'ait été intégralement versée.
La loi n'a pas aboli cette règle, souvent mal
vécue lorsque le défunt a pour héritiers des enfants nés d'une autre union.
Mais elle l'a tempérée, pour qu'ils n'en soient pas de leur poche, en
limitant le montant dû aux sommes recueillies dans la succession.
|
LA NOUVELLE FISCALITÉ DES
PRESTATIONS COMPENSATOIRES
|
|
|
Prestation versée en
argent
|
Prestation en nature
|
|
|
Versée sur moins de 12 mois
|
versée sur plus de 12 mois
|
Fournie sur moins de 12 mois
|
Fournie sur plus de 12 mois
|
|
Pour le débiteur
|
Réduction
d’impôt (1)
|
Intégralement déductible des revenus comme une
pension alimentaire
|
Réduction
d'impôt(1)(2)
|
Aucun
avantage fiscal
|
|
Pour le bénéficiaire
|
Droit fixe de
75 € (3)
|
Imposable
comme une pension alimentaire
|
§
Bien commun
ou indivis acquis pendant le mariage: 1 % de droit de partage
§
Bien
propre immobilier: 0,60 % de taxe de publicité foncière(3)
§
Autres
biens propres: droit fixe de 75 €(3)
|
(1) Égale à 25 % de la
prestation, prise dans la limite de 30 500 €, soit 7625 € de
réduction maximum.
(2) Calculée sur la valeur
du bien mentionnée
dans la convention homologuée par le juge ou dans le jugement de divorce.
(3) Et non plus droits de
donation comme auparavant..
Les donations entre époux ne seront plus remises en
jeu.
L'effet du divorce sur les donations entre époux
La loi reconsidère le sort des donations si les
époux divorcent.
D'une part, celles qui n'ont pas pris effet
pendant le mariage sont automatiquement révoquées, y compris si elles ont
été consenties avant le 1er janvier 2005, si le divorce est
engagé sous le nouveau régime.
Ce qui vise en particulier toutes les donations
prenant effet au décès du conjoint donateur, telles que les donations au
dernier vivant, et, dans les contrats de mariage, les clauses de préciput
ou d'attribution intégrale de la communauté.
Toutefois, ces donations pourront être
maintenues, si l'époux donateur le demande expressément au juge.
À l'inverse, le divorce sera sans effet sur les
donations prenant effet pendant le mariage, pour celles qui ont été
consenties depuis le 1er janvier 2005 (celles qui sont antérieures restant
révocables).
Par exemple, si les époux prévoient par contrat
de mariage que l'un d'eux apporte à la communauté un appartement qui lui
appartenait personnellement avant le mariage, cet appartement fera partie
des biens communs à partager en cas de divorce.
Enfin, la loi entraîne la modification des règles
de l'assurance vie en matière d'acceptation du contrat par le bénéficiaire
(rappelons qu'une fois le contrat accepté, le titulaire ne peut plus, sans
l'accord du bénéficiaire acceptant, désigner un autre bénéficiaire, ni
récupérer son épargne).
Désormais, si le bénéficiaire acceptant est le
conjoint du souscripteur, il conserve ses droits en cas de divorce, ce qui
n'était pas toujours le cas auparavant. Cela, y compris pour les assurances
vie souscrites avant le 1er janvier 2005.
« Pour pallier cette règle, conseille un notaire,
on peut désigner le bénéficiaire du contrat dans un testament déposé chez
un notaire. Le conjoint, même s'il a connaissance du contrat à son profit,
ne pourra pas juridiquement l'accepter. En cas de divorce, le souscripteur
pourra modifier le bénéficiaire dans son testament ».
Enfin, indépendamment de toute procédure de
divorce, la loi réforme profondément le régime des donations entre époux
consenties depuis le 1er janvier 2005. Ces donations, comme toutes les
autres, seront irrévocables. Si les rapports entre les époux se dégradent,
un époux ne pourra plus revenir sur sa donation, sauf ingratitude de son
conjoint (si, par exemple, il est violent).
De nouvelles formes de donations deviennent
possibles.
La loi autorise, par ailleurs, qu'un époux achète
avec ses propres fonds un logement mis au nom de son conjoint. Dans le
passé, l'époux qui avait payé pouvait ultérieurement revendiquer ce bien,
en faisant valoir qu'il s'agissait d'une donation déguisée, interdite et
donc nulle.
Désormais, il pourra seulement faire valoir qu'il
s'agissait d'un prêt de sa part et que son conjoint doit lui rembourser les
fonds.
De même, un époux pourra faire une donation aux
enfants ou aux petits-enfants de son conjoint issus d'une précédente union (donation
par personnes interposées), sans craindre que ses propres enfants puissent
la contester (excepté si elle entame la part d'héritage que la loi leur
réserve).
Risquées sur le plan civil, ces donations
suscitaient la méfiance du fisc. Leur légalisation devrait permettre aux
notaires et conseillers en patrimoine de proposer aux époux des solutions
nouvelles pour améliorer la protection du conjoint survivant, ou optimiser
la transmission de leur patrimoine.
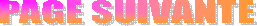 
|